L’audience solennelle de la Cour suprême a pour fondement l’article 33 de la loi N°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Haute Cour, modifiée par la loi N°2017/014 du 12 juillet 2017.
En cette occasion unique, vous voudrez bien me permettre d’aborder avec vous certaines considérations sur un thème d’une brûlante actualité, à savoir la défense sociale face au défi du terrorisme.
Le terrorisme constitue un défi majeur pour l’Etat de droit en ce que l’action des mouvements terroristes a toujours pour effet la remise en cause de l’ordre établi.
Cette action soumet l’Etat à une double menace.
D’une part, l’Etat est directement menacé par des attentats violents visant à répandre la terreur, à porter à la vie, à l’intégrité physique et la sécurité des personnes ainsi qu’à la dégradation du tissu économique à travers la paralysie des activités de production.
D’autre part, l’Etat est soumis à une menace indirecte, plus pernicieuse, à savoir, la tentation à considérer que la lutte contre le terrorisme ne peut être que par la restriction des libertés individuelles en particulier, et des droits humains en général.
Force cependant est de reconnaître que la généralisation du phénomène du terrorisme a fait évoluer le contenu des droits humains et du droit humanitaire.
Le droit humanitaire, encore appelé droit de guerre, rassemble en ses dispositions les valeurs promues par la communauté internationale comme devant être protégées et qui ne peuvent être restreintes par aucun système juridique d’un Etat membre des Nations unies.
Ces valeurs universelles constituent le noyau dur des droits de l’homme et s’imposent pendant les périodes de conflits armés et des crises graves.
La Cour Internationale de Justice a d’ailleurs jugé que ce droit humanitaire établissait des obligations erga omnes et intransgressibles. Lesquelles devraient s’imposer aux Etats sans condition.
Pour cette juridiction supranationale, le droit humanitaire ne devrait souffrir d’aucune transgression de la part du droit interne d’un Etat.
La notion de terrorisme y est perçue, non comme un concept fondant une incrimination, mais comme une circonstance aggravante de certaines infractions de droit commun. Les coupables sont condamnés, non pour terrorisme, mais pour des infractions telles que la prise d’otage, la détension d’armes, le détournement d’aéronefs notamment.
Partant de cette jurisprudence, au Cameroun comme dans d’autres pays, jusqu’à une date récente, la menace terroriste relevait des mesures législatives d’exeption. Pour faire face à une situation exceptionnelle, les pays adoptaient une législation de circonstance, une législation destinée à être actionnée pour une période limitée, et qui cessait de s’appliquer aussitôt que le phénomène prenait fin.
Cette législation était réservée aux situations d’état d’urgence ou d’exception, les actes de terrorisme étant eux-mêmes considérés comme relevant de circonstances exceptionnelles.
L’Ordonnance N°62-OF-18 du 12 mars 1962 portant répression de la subversion au Cameroun et qui a été abrogée par la loi N°90-04 du 19 décembre 1990 paraît appartenir à cette catégorie de législation.
Dans le même sillage, l’article 9 de la loi N°96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972 modifiée et complétée par la loi N°2008/001 du 14 avril 2008 donne pouvoir au président de la République, en cas de péril grave menaçant l’intégrité du territoire, la vie, l’indépendance ou les institutions de la République, pour proclamer par décret l’état d’exception et prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires.
Mais, la législation sur le terrorisme, hier considérée comme une législation d’exception, tend à se banaliser à travers le monde . L’objectif n’est plus de mettre en place une législation transitoire destinée à gérer une situation d’exception, mais d’adopter des dispositions permanentes qui prennent corps dans le système juridique du pays considéré.
L’action normative est désormais tournée vers la sauvegarde de la sécurité des personnes et des biens, ce qui justifie un élargissement considérable de l’arsenal de surveillance et la mise à la disposition des autorités publiques des mesures administratives unilatérales.
Les quatre attentats-suicides perpétrés le même jour du 11 Septembre 2001 aux Etats-Unis par des membres du réseau djihadiste AL-Qaïda et qui ont fait 2977 victimes et 19 pirates de l’air, ont constitué le point de départ d’une véritable ébullition juridique .
Face à l’ignominie de ces attentats, la communauté internationale a résolument pris conscience de la nécessité de mettre en place des mécanismes susceptibles de juguler le phénomène du terrorisme.
C’est ainsi que le 28 Septembre 2001, quelques jours seulement après leur perpétration , le Conseil de Sécurité des Nations-Unies adopte la Résolution 1373 sur la menace à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes , autrement appelée Code anti terrorisme mondial.
Par cette Résolution, le Conseil de Sécurité prend une série de mesures visant au tarissement des sources de financement et autres avoirs des terroristes et de leurs organisations. Il demande aux Etats de coopérer afin de prévenir les actes de terrorisme.
Ladite Résolution forme avec 13 autres instruments internationaux, dont bon nombre avaient été adoptés antérieurement à sa promulgation, le cadre juridique universel de lutte contre le terrorisme.
En vue de l’appropriation des principes qui y sont contenus , les droits. internes des Etats membres des Nations unies se sont enrichis des dispositions de la Résolution 1373 .
Une coopération internationale de lutte contre le terrorisme s’est rapidement développée.
La prise de conscience de l’importance de la menace terroriste au lendemain des attentats de NEW-YORK, a entraîné le renforcement de la nécessaire coopération internationale, aussi bien dans le domaine du renseignement que dans celui de la répression ou encore, de la lutte contre le financement des activités terroristes. La plupart des Etats membres des Nations Unies ont ratifié les différentes Conventions internationales y relatives . Ils ont ensuite légiféré pour se doter des lois internes.
Des textes régionaux ont vu le jour, à l’instar de la Convention de l’Organisation de l’Unité Africaine ( OUA) sur la Prévention et la Lutte contre le Terrorisme adoptée le 08 Juillet 2004 à ADDIS-ABEBA en ETHIOPIE et du Règlement n° 01/3-CEMAC-UMAC du 11 Avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme en Afrique Centrale adopté par les Etats de l’Afrique Centrale.
Cependant, chaque Etat membre a réagi de manière spécifique, en fonction de sa perception de la menace terroriste, du risque réel ou immédiat encouru, de sa définition de l’Etat de droit, voire de ses traditions.
A titre d’exemple, le célèbre USA Patriot Act, loi anti-terroriste votée par le Congrès des Etats-Unis et signée par le Président George W. BUSH, le 26 Octobre 2001 en réaction aux attaques du 11 Septembre 2001, constitue un cas emblématique de l’évolution de l’état d’esprit des Etats de tradition de la Common Law face au terrorisme.
Dans ce pays dans lequel la liberté individuelle constitue un dogme, le USA Patriot Act a autorisé l’accès aux informations privées des personnes physiques et des entreprises.
C’est ainsi qu’ont été autorisés, la transmission au FBI, sans autorisation du juge et hors son contrôle, des informations sur la vie privée des personnes physiques et des entreprises, les écoutes de nature purement administrative, l’enregistrement, la transcription des conversations et autres modes de communication utilisés par ces personnes.
En Grande-Bretagne, the Anti-Terrorism Crime and Security Act 2001 a été introduit au Parlement le 19 Novembre 2001, soit deux mois après les attaques terroristes du 11 Septembre 2001 ci-dessus rappelées.
Promulguée par la Reine le 14 Décembre 2001, la loi subséquente a battu en brèche le principe de l’habeas corpus, en ce que cette loi autorise l’internement administratif des personnes· simplement soupçonnées d’un lien quelconque avec un groupe terroriste, ou encore leur contrôle par diverses méthodes, notamment le port de bracelet électronique.
La mise en application des instruments ainsi adoptés par les EtatsUnis et- la Grande –Bretagne, entraîne donc la suspension ou des restrictions provisoires de certaines libertés individuelles. Ces restrictions font désormais partie de la vie quotidienne des citoyens et la sécurité devient le fil conducteur et la justification des mesures anti-terrorisme. La dialectique sécurité-Iiberté est devenue le lieu commun qui justifie certaines atteintes aux libertés publiques, y compris celles prévues par le droit international humanitaire.
En France, à la suite des attentats survenus à Paris en Janvier 2015, plusieurs voix se sont élevées dans la classe politique pour que soient mis en place des lois et programmes de surveillance renforcés; l’on a parlé d’un « Patriot Act» à la française.
Cette intrusion de l’autorité publique dans les libertés publiques participe de la volonté d’accroitre l’efficacité de la prévention du phénomène terroriste et d’assurer une plus grande sécurité des personnes et des biens.
Le caractère diffus et les difficultés à saisir les différentes formes que revêt le terrorisme contribuent à encourager la tendance de plus en plus commune à étendre le champ normatif . En effet, la menace terroriste peut venir de n’importe où et n’importe quand. Elle ne connaît pas, de frontière. Aussi paraît-il normal que l’Etat ne limite pas les mesures qui seraient de nature à la juguler.
En tout état de cause l’opinion publique largement répandue dans la plupart des grands pays semble désormais admettre que si on n’a rien à se reprocher, on n’a rien à cacher et l’intrusion dans la vie privée ne doit pas être perçue comme étant à priori dangereuse pour les libertés individuelles.
Hier perçues comme des vio1ations intolérables du droit à la vie privée des personnes, la recherche des informations par les fichages informatiques, les investigations dans la vie privée, la vidéo surveillance et l’enregistrement des données biométriques, sont désormais considérées comme des démarches efficaces et nécessaires contre la menace terroriste.
L’ampleur de leur développement, loin de constituer une source d’inquiétude, est de plus en plus admise comme un signe positif vers l’atteinte de l’objectif recherché .
Certains ont cru voir en cette approche sécuritaire une source de danger pour les libertés individuelles, persuadés sans doute que par ce biais, l’Etat réussit à imposer facilement sa légitimité à une opinion publique inquiète.
Ils mettent l’accent sur le risque d’atteinte à l’ensemble des droits et libertés qui, de manière licite , peuvent être affectées par les nécessités de la préservation de l’ordre public.
Par ailleurs, ils croient percevoir dans la lutte contre le terrorisme un alibi pour les Etats pour faire adopter par le pouvoir législatif des mesures destinées à combattre d’autres phénomènes qui ne sont pas nécessairement criminels.
Ainsi, fait-on observer que sous le prétexte de la lutte contre le terrorisme, les pays occidentaux ont accru le contrôle des flux migratoires des étrangers qui tentent de franchir leurs frontières, et ont ainsi facilité les reconduites aux frontières et les expulsions.
Le droit d’asile a été largement restreint alors même qu’il est avéré que la vague des actes terroristes ayant frappé ces pays était, dans la plupart des cas, le fait de nationaux ou de ressortissants des Etats apparemment bien intégrés.
On ne peut avoir oublié les inquiétudes suscitées par le développement de l’informatique en rapport avec la protection de la vie privée et notamment le fichage des personnes et la diffusion des informations ainsi recueillies.
Toutefois, le combat contre le terrorisme rentre dans la recherche d’un équilibre entre le désir de sécurité et le désir de liberté.
Dans ce combat, il est universellement reconnu que le respect des droits de l’homme constitue un allié indispensable. Les Etats se donnent le devoir de ne limiter ce combat que dans le cadre de ce qui est nécessaire et prévu par le droit international, notamment en ce qui concerne le recours à la force.
C’est dans cette logique que devant la recrudescence des actes de terrorisme dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le Président de la République du Cameroun, son Excetlence Paul BIYA, dans son adresse à la Nation le 31 Décembre 2017, après avoir rappelé qu’il avait « instruit que tous ceux qui ont pris des armes, qui exercent des violences ou qui incitent à la violence, soient combattus sans relâche et répondent de leurs crimes devant la justice, a indiqué que « les opérations de sécurisation engagées à cet égard ... vont se poursuivre, sans faiblesse, mais sans excès ».
Au plan judiciaire, la République du Cameroun considère que le respect des droits de la défense dans le cadre des procédures engagées pour réprimer les actes de terrorisme n’est pas incompatible avec l’objectif sécuritaire poursuivi.
Le pays a inscrit ces actes parmi les infractions à la loi pénale, faisant ainsi de leurs auteurs des délinquants de droit commun.
Comme vous le savez , le grand principe qui domine la matière complexe de la délinquance est celui de la légalité de la répression flanqué de son corollaire indispensable, à savoir, la règle de l’interprétation stricte par le juge des dispositions légales.
Le principe de légalité a une force toute particulière.
La règle « nullum crimen, nulla poena sine lege » sert la liberté des individus puisque nuls faits, nulles omissions ne peuvent être punis s’ils ne tombent pas exactement sous le coup d’une incrimination préalablement portée par la loi, le juge ne pouvant se prononcer au nom de principes généraux.
Ainsi, au plan des incriminations, la légalité oblige les magistrats à déterminer l’exacte qualification des faits poursuivis, à rechercher quel texte précis est applicable à l’espèce.
Le juge, en se prononçant sur une infraction, a le devoir de mentionner l’existence des éléments constitutifs prévus par la loi. Il a donc l’obligation de respecter l’existence de la loi . Il ne saurait l’infirmer ou la dépasser. Son interprétation des textes reste littérale, non extensive; elle est téléologique, en ce qu’elle est déclarative de la volonté du législateur.
Et dans ce sens , s’il n’existe pas de texte, le Procureur de la République classe sans suite, le juge d’instruction ordonne un nonlieu, la juridiction de jugement acquitte.
Le terrorisme, en ce qu’il porte atteinte au droit à la vie, à la sécurité des personnes et qu’il provoque la dégradation du tissu économique des Etats , est une forme de délinquance particulièrement attentatoire à l’Etat de droit.
Or, comme toute forme de délinquance, et sans doute plus que beaucoup d’autres formes de délinquance, il constitue un trouble grave &a...
Cet article complet est réservé aux abonnés
Déjà abonné ? Identifiez-vous >
Accédez en illimité à Cameroon Tribune Digital à partir de 26250 FCFA
Je M'abonne1 minute suffit pour vous abonner à Cameroon Tribune Digital !
- Votre numéro spécial cameroon-tribune en version numérique
- Des encarts
- Des appels d'offres exclusives
- D'avant-première (accès 24h avant la publication)
- Des éditions consultables sur tous supports (smartphone, tablettes, PC)










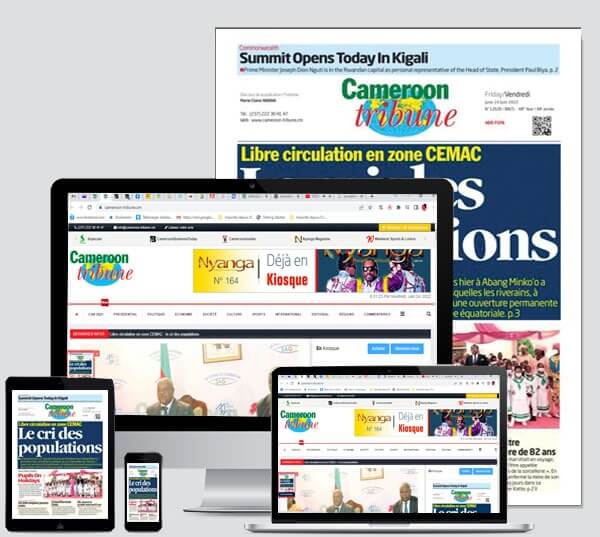


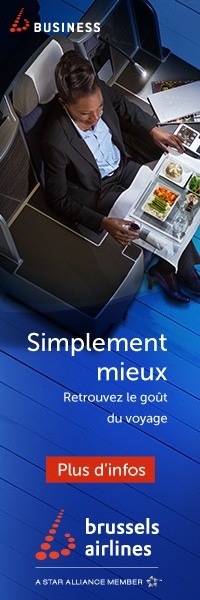
Commentaires